Kelly Reichardt, 2008 (États-Unis)
LE SOIN DES PRÉCAIRES
Il est significatif que Kelly Reichardt associe le territoire à des frais reportés dans un cahier. Deux fois dans le film un plan montre le cahier à spirales de Wendy. La première fois, elle est dans sa voiture à la fin de sa journée et fait un point. Elle est arrivée il y a peu dans ce coin de l’Oregon. Elle ne cesse de le dire, elle y est de passage. La liste qu’elle établit correspond à son trajet à travers les États-Unis du Midwest, l’Indiana où elle a laissé de la famille, à l’Alaska, où elle compte peut-être trouver un emploi. Kelly Reichardt ne fait pas un road movie. Pas d’élan, une perspective mise à mal, son personnage n’avance plus. Le voyage de Wendy est stoppé. Sa voiture en panne et la chienne Lucy échappée, la halte dans la petite ville de Wilsonville se prolonge. Sur son cahier, figure également ses dépenses. Dans sa voiture, carte routière à l’appui, Wendy note le nom de son étape, compte les billets qu’il lui reste et se masse les pieds. Une heure plus tard dans le film, on revoit cette page du cahier complétée. L’étape lui a coûté cher, financièrement, matériellement, psychologiquement. Kelly Reichardt filme la précarité grandissante de cette fille et à travers son histoire de toute une Amérique.
Ce que l’on voit de Wilsonville, 13 000 habitants, même si cela se résume à deux ou trois quartiers, donne un état des lieux socio-économique. L’insistance sur les voix ferrées et le transit des trains de marchandises rappellent que Wilsonville n’est pas une ville particulièrement attractive mais plutôt un simple carrefour dans la banlieue de Portland. Les personnes que croisent Wendy sont des jeunes sans abris, comme elle, ou de petits travailleurs (les caissières, le jeune magasinier qui la dénonce, le garagiste dont on comprend qu’il parie son argent aux courses, et cet homme contraint de faire le gardien de parking à un âge où d’autres ont depuis longtemps pris la retraite). Les espaces traversés sont les mêmes qu’ailleurs : un supermarché et un garage sur une avenue peu fréquentée, les bois où Wendy croit se réfugier une nuit, la fourrière trois kilomètres plus loin et, à la fin, un quartier de petites maisons avec jardin où elle laissera son chien sans rencontrer personne. Le vieux gardien nous apprend qu’une usine employait du monde avant (peut-être Tektronix spécialisé dans les instruments électroniques, racheté depuis par Xerox, le fabriquant d’imprimantes, aujourd’hui un des plus gros employeurs de la ville). Le gardien ajoute qu’il est plus difficile d’avoir du travail aujourd’hui. Ce que l’on voit de Wilsonville donne un état des lieux socio-économique et ne dit rien d’autres.
Dans son livre, L’Amérique retraversée (De l’incidence, Centre Pompidou, 2021), Judith Revault d’Allonnes compare Wendy et Lucy à un survival exclusivement urbain et périurbain. Elle dit aussi que « C’est un film d’action par excellence, non plus entendu comme la succession dramatique d’entreprises spectaculaires et musclées, mais comme l’enchaînement tragique d’actes de résistance à la pauvreté au jour le jour ». Wendy n’a plus les moyens de vivre. Au supermarché, l’abondance des rayons contraste avec le dénuement de la jeune femme. Là, elle se fait prendre en train de voler deux boîtes de pâtée pour son chien et sa position sociale se dégrade un peu plus. Ce qui n’est pas dans le film mais finit de faire de cette marge urbaine un lieu de déprise géographique et humaine, une brève recherche sur Wilsonville nous apprend que si son hôpital psychiatrique a fermé en 1995 (le Dammasch State Hospital), c’est pour finalement laisser place à une prison pour femmes ouverte en 2001 (le Coffee Creek Correctional Facility). L’information ne va pas contredire Gus Van Sant qui, au cours d’une discussion avec la cinéaste, explique qu’à ses yeux Wendy et Lucy est une histoire « du déclin » dans laquelle « on finit par atteindre un désespoir abyssal » (L’Amérique retraversée, Entretien). Wendy ne passe par la prison pour femmes mais à considérer ses notes sur son cahier à spirales et à ce qu’elle a laissé à Wilsonville, on a peur de penser à l’étape suivante.
Dans un article, Agathe Presselin remarque que les personnages de Wendy et Lucy ne laissent aucune trace sur le territoire (« Wendy a disparu », Apaches n°3, août 2021). « Elles surgissent du vide et ne s’inscrivent nulle part ». Il est vrai que, même au commissariat, la machine à prendre les empreintes peine à enregistrer celles de Wendy. Seule, sans ressources ni aide, la jeune femme est déjà en train de disparaître. Quand on en prend la mesure, la gentillesse du vieux gardien de parking, le seul à prêter attention à elle, touche alors d’autant plus.

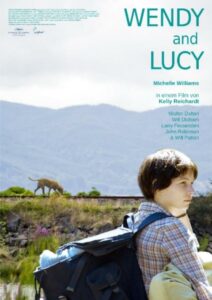



Les films de Kelly Reichardt sont encore confidentiels et je trouve ça dommage. J’en assure une modeste promotion auprès de mes proches, car j’ai aimé tous ceux que j’ai vus, avec un coup de cœur particulier pour Certaines femmes (où l’on retrouve Michelle Williams, ainsi que tu le soulignes dans ta propre chronique de ce beau long-métrage).
Merci de nous rappeler l’existence de Wendy et Lucy, Benjamin ! Il faut que je ressorte mon DVD de la pile des films à voir…
J’ai moi-même dans ma propre pile un ou deux films à voir, Old joy (2006) devrait être le prochain !
« Wendy & Lucy » est une chronique d’une disparition que tu décortiques avec soin et précision. Je note les références à l’ouvrage de Judith Revault d’Allonnes que je n’ai pas encore acheté mais qui semble être une documentation riche de clés de compréhension des film de Mme Reichardt. De quoi voir et revoir ses films qui sont d’abord, et chaque fois, un humble ravissement.