Damien Chazelle, 2017 (États-Unis)
HOLLYWOOD CHANTAIT ET DANSAIT
C’est dans un torrent d’optimisme tel que celui de Chantons sous la pluie de Donen et Kelly (1952) que l’on plonge dès la scène d’ouverture. Une boucle autoroutière sous un ciel bleu en décor, les tours de Los Angeles encore loin dans le paysage et les automobilistes coincés dans leurs tracas avant que la musique ne les entraîne. A l’image du ballet coloré des forains dans Les demoiselles de Rochefort (Demy, 1967), ici tous sortent de leur voiture et se mettent à chanter et danser sur le titre Another day of sun. Ils virevoltent, entrent dans le champ d’une acrobatie et en sortent d’une cabriole ou d’un jeté. La caméra fluide et rapide ne cesse de se déplacer entre les danseurs, autour des voitures ou au-dessus d’elles, suivant un skate ou devant un trio de jazz soudain sorti d’une fourgonnette. Damien Chazelle glisse entre les personnages et place d’emblée le spectateur au cœur de ce tourbillon enthousiaste.
INVITATION A LA DANSE
L’entrée en matière n’est pas simplement joyeuse ou spectaculaire, par ses angles et ses mouvements de caméra, le réalisateur de Whiplash (2014) apporte aussi son originalité et rompt avec la mise en scène traditionnelle de la comédie musicale : la délimitation entre la scène et le public. Dans La La Land, non seulement, comme dans n’importe quel film de Minnelli ou les plus musicaux de Demy, la scène peut-être partout transposée (la maison, les collines, la rue…), mais la distance imposée par l’absence de contrechamp entre les spectateurs et les comédiens symboliquement abolie. Pourtant, dans le tout premier plan de La La Land, cette distance est d’abord maintenue : le travelling latéral nous fait longer la barrière de sécurité de l’autoroute pour nous faire voir un défilé de voitures et entendre les ambiances musicales variées des autoradios. Dans ce plan, le spectateur est coupé des comédiens par une ligne matérialisée par la barrière de sécurité, comme si la quatre voies faisait office de scène et qu’il était rappelé à celui qui avait payé sa place que l’accès aux planches lui restait interdit. Cependant, la diversité des mouvements de caméra et la multiplication des points de vue qui suivent (champs et contrechamps, rotations dans l’axe, etc.), ainsi que le franchissement à plusieurs reprises par les danseurs et la caméra de ces barrières de béton donnent l’illusion d’une invitation faite au spectateur. Les danseurs et les chanteurs ne sont plus seulement devant l’objectif, ils cernent la caméra. De cette façon, la réalisation donne l’impression au spectateur d’être convié à prendre part au ballet. Plus loin, lors de la scène de la fête, dans la piscine, l’idée est répétée : l’euphorie générale semble tout emporter et le spectateur est à nouveau convié, voire cette fois, d’un mouvement de caméra en contre-plongée, gagné par l’ivresse de la soirée.
DONNEZ-LUI UNE CHANCE
L’histoire est une romance. C’est la rencontre de deux doux rêveurs, Mia la serveuse qui passe occasionnellement quelques auditions et Sebastian le pianiste qui aimerait un jour pouvoir racheter un club de jazz mythique tombé dans l’oubli. Ils tombent amoureux malgré ce qu’ils disent sur une colline d’Hollywood (« not a spark in sight »). Ils se séparent malgré une envolée stellaire à l’observatoire Griffith (où d’ailleurs un pendule hésite quant à leur avenir). Le film traite de la désillusion amoureuse ou professionnelle et peut-être d’abord de la désillusion de pouvoir faire une comédie musicale qui appartiendrait à un âge d’or révolu.
Mais en choisissant Emma Stone et Ryan Gosling comme acteurs principaux, Damien Chazelle sait pertinemment que sa propre comédie musicale est un acte manqué. Les numéros dansés des deux acteurs sont affreusement plats et l’hommage comparable au dessin d’un enfant de 5 ans qui aurait tenté la copie d’un tableau de maître, charmant mais vain. La chorégraphe Mandy Moore n’est pas en cause [1]. Emma Stone et Ryan Gosling ne sont pas danseurs. Pourtant, les deux acteurs qui jouent Mia et Sebastian font illusion quand il s’agit de chanter (ils ne sont pas doublés) et Ryan Gosling est même allé plus loin, apprenant le piano en trois mois, il joue ses morceaux avec une dextérité parfois impressionnante pour un débutant (sur les passages à solos, on cherche les plans de coupe sans les trouver). Le chant, le piano, mais pas la danse. Damien Chazelle aurait bien sûr pu demander à ses acteurs quelques semaines de répétitions supplémentaires et leur imposer de calquer leurs numéros sur ceux de Cyd Charisse ou de Gene Kelly. Il aurait aussi très bien pu choisir des artistes accomplis de Broadway qui auraient été capables de tout faire en mieux. Non, pour ce qui est de la danse au moins, il préfère laisser ses acteurs maladroits et sans adresse. Et l’on préfère qu’il en soit ainsi. Quel intérêt en effet y aurait-il eu à copier entièrement un genre sans appartenir à son époque ? Qu’en serait-il sorti ? Une performance, et ensuite ? [2]. C’est pourquoi en dehors de l’épatant et très ensoleillé ballet introductif (duquel Ryan Gosling et Emma Stone sont exclus), les évocations des plus belles comédies musicales des années 1950 et 1960 s’avèrent, sur le plan de la danse, très résiduelles : des expressions passées, de lointains souvenirs. On peut le dire autrement : dans La La Land, les danses sont nulles. Toutefois, le réalisateur connaît ses limites et en fait un atout.
Damien Chazelle mêle les images et les références et il nous semble que la mémoire nous joue des tours. Ainsi, le Dancing in the dark de Fred Astaire et de Cyd Charisse, léger, complice et envoûtant (dans Tous en scène de Minnelli, 1953) n’est plus qu’un décor pour un échange un peu filou (A lovely night où Mia et Sebastian se mettent d’accord sur leur soi-disant absence de sentiment l’un pour l’autre). Dans le même temps, pour ses couleurs et à nouveau son décor, cette scène rappelle tout autant le You were meant for me de Chantons sous la pluie : « a beautiful sunset, colored lights in a garden, a soft summer breeze, 500 000 kilowatts of stardust ». Et toujours dans cette scène, le seul mouvement de Ryan Gosling autour d’un réverbère esquisse bien maladroitement celui de Gene Kelly dans son numéro le plus connu. Ailleurs, la danse disparaît tout à fait lorsque Emma Stone auditionne pour une série policière sur fond de murs en briques rouges ou pour une série hospitalière sur un fond vert pâle. Ces tableaux nous sont familiers : c’est ainsi que Henri Baurel nous présentait Lise de ses yeux amoureux dans Un Américain à Paris (Minnelli, 1951). Leslie Caron (Lise) jouait à chaque plan un rôle différent identifié par différents décors à couleur unique [3]. Mais Leslie Caron danse, alors qu’Emma Stone, cadrée en plan rapproché, ne danse pas. Idem, les souvenirs se mêlent quand Emma Stone invitée à une soirée joue avec un rideau comme s’il s’agissait d’une robe : c’est à la fois à Natalie Wood que l’on pense, entourée de ses amies dans I feel pretty (West side story, Robbins et Wise, 1961), et à Gene Kelly et Donald O’Connor qui tourmentent leur professeur de diction et se parent un instant de toges improvisées dans Moses supposes (Chantons sous la pluie). Idem, la visite à l’observatoire donne lieu à une très belle scène où les danseurs de leurs pas foulent un tapis d’étoiles, ce qui n’est pas sans évoquer, pour prendre des références plus récentes, les élévations d’un Allen et d’un Luhrmann (Tout le monde dit I love you, 1996, Moulin Rouge !, 2001).
STRIKE UP THE BAND
Cet hommage impossible aux comédies musicales s’assumant totalement, peut-on chercher matière ailleurs ? La La Land rumine une autre idée qui semble tarauder son réalisateur et à laquelle il est très facile de lier la précédente. Devant sa glace d’artiste, peinant à prévoir sur le long terme, Sebastian se demande où est sa place : à jouer dans un groupe de funk à tendance pop endiablée et par conséquent trahir son rêve (voir tous les moyens déployés sur Star a fire)… ou bien se contenter de le caresser à jamais de notes trop fidèles à Hoagy Carmichael ou Thelonious Monk.
« You holding on to the past… but jazz is about the future. »
La La Land, on l’a vu, ne veut surtout pas s’en tenir à n’être qu’une vieille chose. Celui qui a réalisé le déjà jazzy, dansant et très prometteur Guy and Madeline on a park bench (2009) -alors qu’il n’était encore qu’étudiant-, enrichit son thème principal de quelques autres lignes mélodiques dans un entrelacs résolument moderne.
Au début de leur relation, Sebastian tente de comprendre ce qui déplaît à Mia dans le jazz. Installés à une table dans un club, un groupe joue devant eux. Le passionné explique ce que fait chacun des musiciens et donne sa propre approche du jazz à la néophyte. « Regarde les. Le joueur de saxo. Il fait son propre voyage. Chacun recompose, réorganise, réécrit et ils jouent la mélodie… ». Sebastian dit ensuite une phrase sur les compromis auxquels les musiciens qui jouent un même morceau doivent se résoudre, mais on n’est plus tout à fait sûr de savoir de quoi il parle : du jazz, de sa relation avec Mia, ou du travail du réalisateur… Ce dernier ne réarrange-t-il pas ses influences pour créer quelque chose de neuf ? « It’s new every time. It’s brand new every night ». Ces influences réciproques entre musiciens, pour ne pas perdre le jazz de vue, participent à la création ; les improvisations de chacun se nourrissent les unes des autres et entraînent le thème principal plus ou moins loin. Ces influences réciproques sont aussi celles du couple. C’est ce que l’on comprend dans la scène aux rideaux « verts-Pygmalion » (comment surnommer cette nuance de vert différemment depuis Vertigo ?) qui nous révèlent déjà tout de la situation. Sebastian et Mia se disputent pour ce qu’ils sont devenus et pourtant les choix qu’ils ont fait ont été soufflés par l’autre. Mia conseillait à Sebastian de ne pas laisser passer l’offre qui lui était faite, jouer dans un groupe (The Messengers, qu’il a pourtant commencé par critiquer). Elle lui reproche à présent de consacrer tout son temps à une musique qu’il n’est même pas censé aimer. Mais Mia subit aussi son influence. Tous les deux sont sur la même partition. Elle finit donc par aimer le jazz. Mieux, sa dernière audition, la seule qui la sauve de sa vie de serveuse et lui garantit un succès d’actrice, Mia la réussit car pour la première fois, comme en jazz, elle improvise.
ALL THAT JAZZ
On ne reprochera finalement pas à Damien Chazelle la platitude des numéros de danse. Emma Stone et Ryan Gosling n’ont définitivement pas « la magie rythmique des pas immortels d’un Gene Kelly » (ou bien d’un Bill Robinson dans la version originale du film de Minnelli), et c’est tant mieux. Leur charme suffit amplement. On ne reprochera pas non plus l’absence de grand finale, du moins un finale trop court, quatre fois plus court que celui des Chaussons rouges (Powell et Pressburger, 1948), trois fois plus court que dans Papa longues jambes, deux fois plus court que dans Tous en scène… Le choc de Mia crée la véritable surprise finale. Une désillusion qu’elle ne réalise que très tard. Devant le groupe de jazz et parlant du jazz qu’il aime, Damien Chazelle ajoutait ces mots dans la bouche de Sebastian : « And it’s dying. It’s dying, Mia, it’s dying on the vine. And the world says: »Let it die. It had its time. » Well, not on my watch ». La désillusion est mise en abyme. Et tout ce temps-là, Hollywood chantait et dansait.
[1] Mandy Moore est connue pour ses chorégraphies pour la télé (les émissions American Got Talent et American Idol). Elle a également travaillé sur les films de David O. Russell (Happiness therapy, 2013, American bluff, 2014 et Joy, 2015 ; les trois d’ailleurs avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper).
[2] On pense à toute l’audace formelle de The Artist de Michel Hazanavicius (2011)…
[3] Sans le changement de couleurs, les différentes personnalités ainsi présentées dans un tableau se trouvaient déjà dans Un jour à New York de Donen et Kelly (1949) avec le numéro de Vera-Ellen (« Miss Turnstiles »). L’idée est encore détournée dans Daddy long legs de Negulesco (1955) dans lequel Leslie Caron imagine Astaire incarner différents personnages.

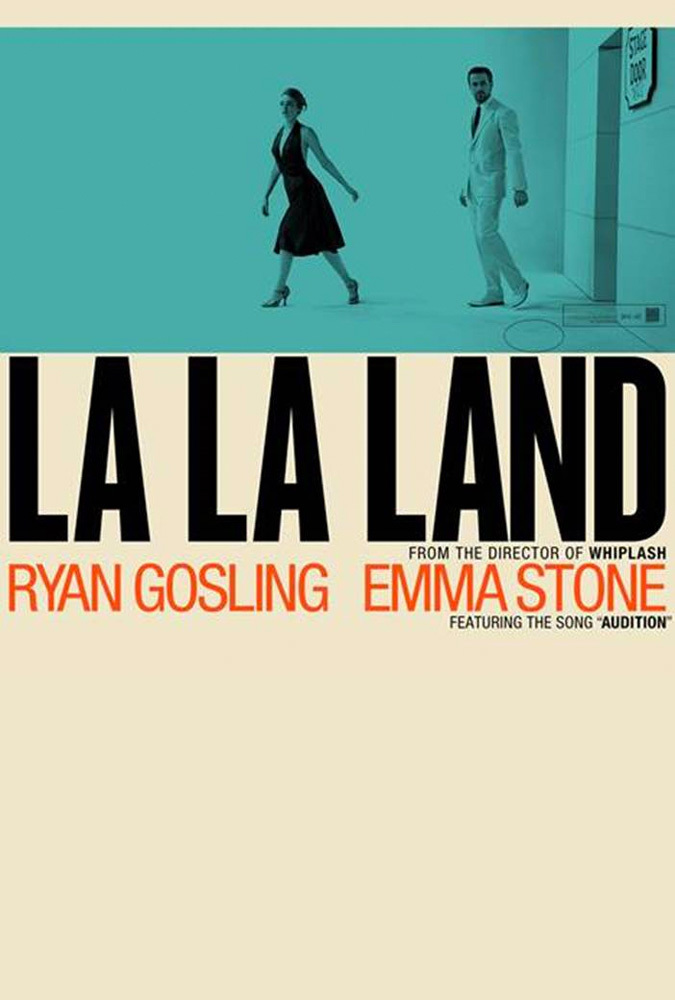




Il y aurait beaucoup à dire sur cette ouverture qui, bien qu’attaquée de toutes parts par toux ceux que le succès du film agace, marque les esprits. Chazelle nous invite à sortir de nos carcans (ce n’est pas si souvent qu’un film chante la vie, sans simplement transposer un succès de scène sur grand écran) : l’embouteillage, scène de la vie ordinaire à Los Angeles, manifestation évidente d’une société immobile (on peut penser au Trafic de Tati également), mise en boîte, devient un espace d’expression hors du commun. Les références à Demy (et à Ophuls par la même occasion) sont amoureuses, les citations venues des quatre coins du cinéma américain sont légions : outre les ténors du musical, il y a un peu de La vie est belle de Capra dans cette vision « alternative » du récit, évidemment Nic Ray, mais aussi pourquoi pas un peu de la magie du vieux Griffith dans la nom de cet observatoire des hauteurs. Et je ne parle pas des rideau « vert-Pygmalion » en effet !
J’ai l’impression que le disque bleu tourne en boucle sur la platine et que les mélodies se fredonnent en rentrant du boulot, me trompe-je ? En tous cas ce bel article m’a remis sérieusement en tête l’envie de les fredonner aussi.
« rideaux », je me suis pris les pieds dedans en cabriolant comme un bienheureux. 🙂
Les références sont en effet très nombreuses, et comme toujours au cinéma certaines en appellent toujours d’autres.
Par exemple, concernant les embouteillages, avec Trafic, 8 1/2 (aussi !). Comme Fellini, Chazelle ouvre son film par un bouchon (c’est presque un calembour à la Demy).
ps : j’ai bien bien aimé la cabriole du bienheureux, j’ai donc laissé ta coquille initiale.
« 8 1/2 » bien sûr !
Chazelle pousse le bouchon même pour certains ! Je reconnais, comme dirait Gene, que « l’astuce est étonnante ».
Effectivement, le film fourmille de références et d’hommages (bien employés d’ailleurs, quoique me concernant, j’ai moins aimé les rideau verts empruntés à Vertigo qui m’ont fait sortir du film un instant), mais son mérite est sans doute d’exister par lui-même et de pouvoir être apprécié par ceux qui n’ont jamais vu de Minnelli ou de Demy. Une belle réussite. J’aime bien ton idée de Mia qui réussit son audition lorsqu’elle se met à improviser comme en jazz.
Moi j’ai aimé les rideaux et la lumière empruntés à Vertigo. Je me suis même surprise à rapprocher la robe verte de Mia lors de la scène au Planétarium à l’étole de Madeleine quand Scottie la voit pour la première fois au restaurant. Le chignon de Mia (toujours dans la même scène) est également évocateur.
Enfin, l’un des titres de la BO: « Summer montage / Madeline » me rend curieuse, mais je redescends sur terre et imagine qu’il s’agit simplement d’un emprunt à Guy & Madeline on a park bench.
En revoyant La La Land, j’ai apprécié d’autres choses :
– le phare qui sert de symbole sur la scène où Seb joue encore du « pur jazz »
– le super-8 très touchant, pellicule jaunie d’un rêve envolé
– toute la magie à l’observatoire, les ombres portées, les couloirs où l’on se perd, l’électricité dans l’air et le baiser sur des fauteuils, presque de cinéma
– ce premier baiser à la fin du printemps, à l’observatoire donc, qui est donné à l’exacte moitié du film (à vérifier !)
– ces deux images gigantesques d’Ingrid Bergman, l’une sur un mur de chambre en couleur (quand le rêve est encore possible), l’autre cinq ans plus tard dans une rue de L. A. en noir et blanc (quand le rêve est passé)
– ce raccord entre le feu d’artifice et le panneau rappelant les heures de la fourrière (retour à la réalité en un raccord amusant)
– ce raccord entre le rapprochement amoureux de Seb et Mia au cinéma, et la pellicule qui brûle (retour à la réalité en un raccord amusant)
– ce pas de danse sur la première version chantée de City of stars, avec une dame un peu âgée sur la jetée, puis son mari qui donne un petit coup à Sebastian pour montrer son désaccord avec l’air de dire « qu’est-ce que tu crois là ? »
– la 2ème version de ce titre chantée à deux, juste après l’engagement de Seb dans The Messengers, c’est l’été, une auréole au plafond et le début d’une désillusion
– pour le passage des saisons imperceptible dans la météo, mais tout à fait dans les états d’esprit et les sentiments
– pour le fauteuil vert-Pygmalion sur lequel Seb et Mia attendent avant l’ultime audition
– pour le regard complice de ma fille quand elle constate que Ryan Gosling ne vaut ni Astaire et encore moins Kelly
– pour le regard complice de ma fille quand elle aperçoit un marin dans le finale
– pour un moment que j’ai partagé avec elle et que j’ai failli manquer (puisque nous étions partis pour voir un dessin animé excité et sans intérêt)
Boudi, quelle critique et quelle analyse ! Ton papier est vraiment très bien écrit et c’est bien analysé (et je dis ça alors que je ne suis pas spécialement fan du film, qui m’a même carrément déçue, même si je lui reconnais d’évidentes qualités).
comment s’appelle la chanson que Mia demande au groupe devant la piscine
Je lève le bras bien haut comme Mia : I ran ! (A Flock Of Seagulls)
https://www.youtube.com/watch?v=iIpfWORQWhU