S’appuyant sur Serge Daney qui faisait de la carte l’image fondamentale naturellement associée à sa cinéphilie, Manouk Borzakian propose de se lancer avec le cinéma dans une conquête géographique nouvelle. Ainsi, sur son blog Le monde dans l’objectif, qui habituellement fusionne déjà les territoires géographiques et cinéphiliques, il publie les notices commentées par d’éminents collègues ainsi que celle d’un sombre anonyme (moi !) sur des films variés passés au crible du « regard géographe ». L’occasion pour nous de proposer un petit mélange.
Conte d’hiver, Eric Rohmer, 1991 (France)
Eric Rohmer est présenté comme le « cinéaste géographe ». Dans sa filmographie, ses films qui datent des années 1960 et 1970 sont peut-être les plus convaincants pour évoquer l’évolution des villes, Paris notamment, mais je ne crois pas qu’il y ait une seule de ses réalisations qui ne propose un déplacement, une déambulation ou même une simple promenade dans la capitale ou ailleurs et qui ne permette d’apprécier les paysages environnants. Dans son Conte d’hiver les déplacements sont aussi nombreux et variés : à pied, en bus (le n°94 de Levallois), RER, métro ou train (Paris-Nevers) pour assurer la jonction entre Paris, sa banlieue et la province (d’un été sur un littoral à l’hiver dans la capitale). Un plan sur une pancarte pour évoquer la transformation urbaine. Les villes en réseau, les villes en mouvement, l’espace du conte est urbain et enrichit l’horizontalité développée par Rohmer dans son cinéma.
Journal de France, Claudine Nougaret et Raymond Depardon, 2012 (France)
Qu’est-ce que les paysages filmés et photographiés par Depardon ont de politique ? Lorsque les temps et les époques se superposent sur une façade de rue ou de part et d’autre d’un axe de communication, Depardon souligne les choix faits en matière de rénovation urbaine et d’aménagement du territoire. Dans les petites villes, si tel ou tel commerce nous donne un sentiment d’abandon, il nous faut penser à son possible contrechamp, celui des surfaces commerciales qui en périphérie happent toute activité. Dans ses entretiens, Depardon raconte d’ailleurs volontiers ces transformations périurbaines, observées à Villefranche-sur-Saône, près de la ferme familiale…
A touch of sin, Jia Zhang-Ke, 2013 (Chine)
Où il est toujours question de mutations des territoires. A touch of sin fragmente les territoires, interrompt l’élan des personnages, rompt leurs destins. Davantage que dans ses films précédents, Jia Zhang-Ke rend compte de la violence du séisme qui, depuis que la Chine a entamé la fusion du communisme et du capitaliste et qu’elle a fait de ses littoraux les plus grands carrefours de la mondialisation, n’a cessé de transformer ses paysages, de bouleverser la société et de creuser les fractures entre le peuple et l’élite. De façon plus générale, dans le cinéma de Jia Zhang-Ke (citons Still life, plus simple, plus poétique, tout aussi beau), c’est toujours de cette onde de choc et de ses répliques dont il est question.
Zabriskie Point Michelangelo Antonioni, 1970 (Etats-Unis)
D’abord une coïncidence, je venais d’achever City of Quartz de Mike Davis juste avant de voir Zabriskie Point et le film d’Antonioni s’est révélé être un parfait prolongement du livre : même territoire parcouru et étudié, même critique de la consommation de masse, même critique du sentiment d’insécurité partout véhiculé, même constat sur la domination exercée par les promoteurs immobiliers… De plus, Antonioni parvient à rendre compte de la complexité géographique et économique, à décrire dans le détail les aménagements et leurs acteurs, sans négliger sa fiction ni pour autant se priver de scènes d’une grande fulgurance artistique. Zabriskie Point est en cela assez captivant.
Paris Texas, Wim Wenders, 1984 (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni)
Zabriskie Point et Paris Texas sont deux films très comparables. Cependant ma préférence va au Wenders. On s’identifie davantage à ce paumé de Travis plutôt qu’à Mark l’insoumis d’Antonioni. Au début, Harry Dean Stanton est perdu en plein paysage de westerns, comme s’il venait de traverser l’écran pendant la projection d’un Ford ou d’un Hawks. Marginal dans la poussière des bords de route, il débarque au milieu de nulle part. Mais en faisant de Jane, la femme aimée, sa quête première, il traverse toutes les frontières, quitte le désert pour le plein (géographique, affectif, identitaire), franchit les ceintures autoroutières et traverse la ville pour la retrouver.
Fright night, Craig Gillespie, 2011 (États-Unis)
Il est temps de s’aventurer un peu du côté du fantastique et de voir ce que le genre a à nous dire de géographique. Les banlieues pavillonnaires sont très souvent le théâtre privilégié pour toutes sortes d’apparitions, manifestations, transformations spectrales, sanglantes, slashantes, gluantes… Bref les banlieues résidentielles les plus propres avec leur carré de pelouses ouvertes sont le territoire idéal des monstres et ce jeu sur les façades et sur l’hypocrisie dont elles sont la métaphore est au cinéma parfaitement exploité par le genre. Dans Fright night, petite série B pas trop maladroite, il est question d’un vampire qui emménage un quartier résidentiel de la périphérie de Las Vegas… Et de la banlieue américaine « normale » au bain de sang, il n’y a qu’un pas que Colin Farrell franchit un sourire au coin des lèvres. De quoi donner à réfléchir sur les sprawls horrifiques…
Avengers, Joss Whedon, 2012 (États-Unis)
D’une part, parce que les super-héros ça sert d’abord à faire la guerre. D’autre part, parce que ce film met en avant au milieu de New York la tour Stark qui devient après deux heures d’aventures et d’effets spéciaux la tour des Avengers. Je crois qu’il y aurait matière à faire toute une étude sur la représentation des métropoles américaines au cinéma et notamment sur leur « verticalisation ». On évoquait l’horizontalité des parcours dans les films de Rohmer et nous voici maintenant comme King Kong à l’assaut des gratte-ciel de l’autre côté de l’Atlantique. Alors pourquoi ce film en particulier ? Parce que le film de Joss Whedon sort dans les salles en avril 2012, en même temps qu’un article paru le 1er mai dans Le Monde qui avait pour titre « Le One World Trade Center domine à nouveau New York »… Comme une ombre projetée depuis le Financial District sur Midtown, la tour Stark donne alors des indications sur la restauration d’un symbole.
It follows, David Robert Mitchell, 2014 (États-Unis)
Autre ville, autre sujet. Entre crise destructrice et lente reprise des activités, Détroit la moribonde, Détroit la lazaréenne intéresse le cinéma depuis quelques films et notamment avec It follows. Le film traite de la transmission d’un mal par relations sexuelles : le dernier atteint est le seul à voir un spectre qui tôt ou tard, jamais las, n’importe où, le rattrapera et le tuera. Le sujet nous intéresse justement en devenant la métaphore d’une contamination par la misère dans un premier temps et à celle opérée ensuite (grâce à l’emprise nouvelle d’un ou deux milliardaires) par la reprise économique. Les maisons d’abord abandonnées une à une, quartier par quartier, demeures idéales pour fantômes et zombies, puis rachat d’immeubles et de blocs entiers dans un centre abandonné des politiques mais in extremis investi par des vampires.
Cemetery of splendours, Apichatpong Weerasethakul, 2015 (Thaïlande, Royaume-Uni, France…).
Fascinante représentation de la Thaïlande (« cimetière des splendeurs »). La lente et douce poésie qui s’en dégage ne dénaturerait par les ruines d’Ayutthaya, les temples de Sukhothai ou les dernières traces laissées dans la pierre par les dieux indiens de l’empire khmer. Toutefois, rien d’aussi impressionnant ni d’aussi touristique dans le film. Un cimetière, un palais, une école et un hôpital, les lieux comme les mémoires sont disposés en strates et parfois se confondent. Un labyrinthe ouvert, des soldats endormis, une thérapie expérimentale à base de faisceaux de lumière colorée et une évocation politique à côté de laquelle on ne peut passer alors que la Thaïlande subissait en 2014 son vingtième coup d’État depuis la fin de la monarchie absolue. « Nous alternons des cycles de rêves et de coups d’État. »
Suite armoricaine, Pascale Breton, 2015 (France)
Il n’est pas besoin de savoir que Pascale Breton a suivi des études de géographie pour s’apercevoir de la vive attention accordée aux lieux ainsi qu’au parcours de ses personnages dans son superbe film. Notons d’abord, une fois n’est pas coutume, une inversion des notions de centre et de périphérie : Paris (où enseignait le personnage de Françoise) devient la périphérie de Rennes et à son tour la métropole bretonne devient la périphérie d’un lieu plus important aux yeux de Françoise. Ailleurs, d’une façon surprenante, les immeubles de la cité étudiante de Villejean à Rennes sont parfois plongés en pleine végétation. L’impression presque fantastique qui s’en dégage, l’émergence des bâtiments d’une forêt géante, contribuent à l’étrangeté diffuse du film. Suite armoricaine définit aussi une identité régionale forte autour de la langue, de la culture, de l’histoire contemporaine du territoire… Un film magnifique aux mystères inattendus.



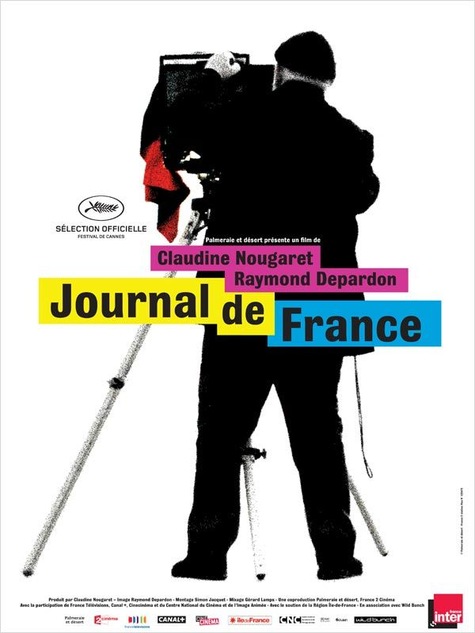

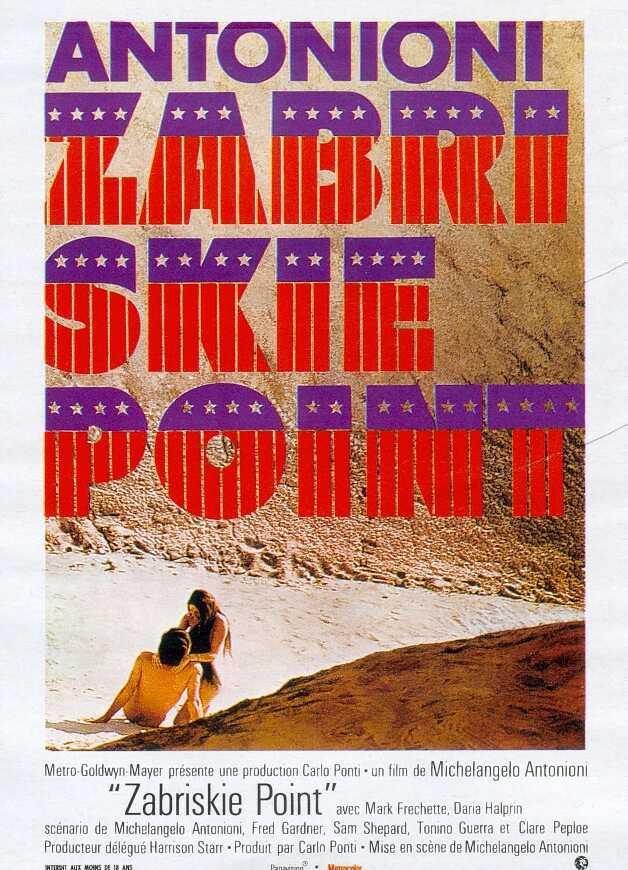
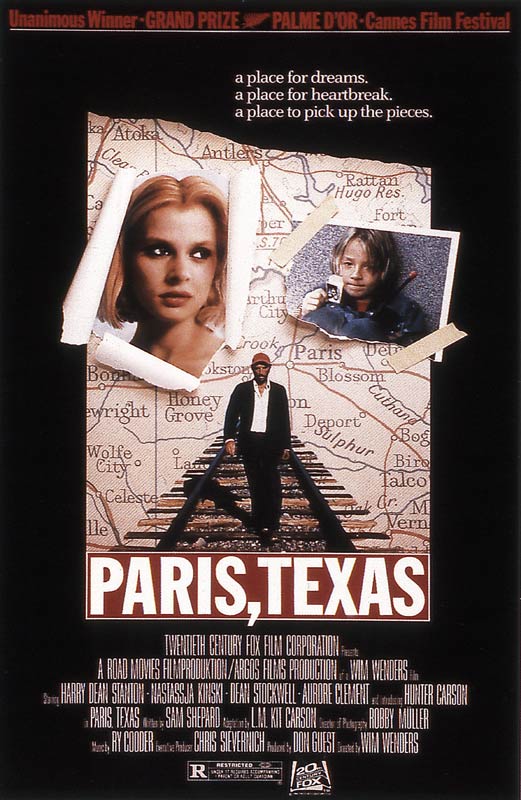





Quel voyage dites moi ! de la Grosse Pomme déguisée pour le Carnaval des (demi-)dieux à l’Ille-et-Vilaine, en passant par la Thaïlande (sans curé), la Mandchourie, Las Vegas (là il en faudrait peut-être un) et la Vallée de la mort, ça fait un sacré périple qui donne à voir. Merci pour ces petites cartes postales souvenirs.