Jean Epstein, 1928 (France)
LA CHUTE DANS L’UNIVERS EPSTEIN
Dans l’intrépide revue Zoom Arrière, quatrième numéro sur le Cinéma muet français, il y a cet article de Marie-France Leccia au titre admirable :
« E.P.S.T.E.I.N : Enfant Prodige des Surimpressions, des Temporalités Étrangères et des Imaginaires Navigants »
L’autrice commente sa découverte de La Chute de la maison Usher et décrit une scène qui l’a fascinée au point d’en vouloir retrouver la sensation dans les autres films du cinéaste. La lecture de l’article a fait effet sur moi et c’était à mon tour de mettre un pied dans la poétique lugubre que le domaine d’Usher avait inspiré à Epstein.
Dans les toutes premières images du film, un homme dont on ne voit pas encore le visage met un pied dans la boue, contourne un étang, parvient finalement à une auberge. Le sol est peu commode et familier à la fois. Dès le début, on s’enfonce dans ce film devenu poreux à force d’influence. On pose un pied et c’est un ailleurs que l’on traverse un instant. L’homme d’un certain âge cherche une voiture qui le conduise le soir-même à Usher et la caméra fait des mystères. Il sort une lettre, une loupe : il est invité à Usher. Je ne sais plus si la diligence est dans la nouvelle d’Edgar Allan Poe (The Fall of the House of Usher, 1839). En revanche, s’impose assez vite à notre esprit le Nosferatu de Murnau (1922) et tous ces Dracula qui s’empressent de mettre à disposition une hippomobile à notre au service pour nous conduire, sinon à notre perte, droit vers des ennuis délicieux et terribles.
Dans la maison aux vides immenses, les décors ont dû plaire à Jean Cocteau. Une cheminée gothique à la taille impossible, le couloir de rideaux épais bougés par le vent, les feuilles mortes au sol et les armoires de livres qui soudain, de leurs étagères, tombent au ralenti : les intérieurs figent le temps comme Roderick le portrait de sa femme, pour ne pas dire sa femme en personne, sur la grande toile qu’il retouche quand la passion le prend. Dans l’adaptation de Jean Epstein, Roderick et Madeleine (Jean Debucourt et Marguerite Gance) sont époux, alors qu’ils sont frère et sœur dans la nouvelle de Poe. Roderick est un artiste. Quand il joue de la musique, il s’accorde avec les ondes du lac et le souffle dans les arbres. Quand il peint, il donne vie à son sujet, tout en ôtant celle de son modèle. Grâce à un scénario auquel aura peut-être contribué Luis Buñuel (noté assistant réalisateur), Epstein raccorde dans ce film d’une heure à peine deux nouvelles d’Edgar Poe, La chute de la maison Usher et Le portrait ovale. Avec ce portrait ajouté, bien sûr, c’est un peu Dorian Gray qui se joint au bal fantasmagorique et admirable. Mais des liens plus forts sont à chercher du côté de Rebecca d’Alfred Hitchcock (1940), en raison de la relation de domination qu’exerce l’homme sur sa femme, d’une demeure impressionnante qui finira dans les flammes, de la fascination qu’exerce un portrait et du fantastique diaphane dont se nourrit tout le film. La maison Usher entraîne d’autres images dans sa chute, on en retrouvera trace dans le Vampyr de Carl Dreyer (1932) ou Sueurs froides d’Hitchcock (1958), cette dernière référence justifiée en raison du portrait maudit et d’une Madeleine revenue d’entre les morts.
Probablement n’aurais-je pas été touché tout à fait aux mêmes endroits du film que ceux que décrits Marie-France Leccia dans son article. Mais elle a raison, Epstein est bien l’Enfant Prodige des Surimpressions, des Temporalités Étrangères et des Imaginaires Navigants. Les plans qu’il fabrique, à l’aide des directeurs de la photo Georges et Jean Lucas et de toute son équipe, sont sans équivalents. Composition, mouvements des corps et de la caméra impressionnent. Epstein tend la main à Méliès (regardons un peu la chapelle où le cercueil de Madeleine est déposé), tout en imaginant des formes d’avant-garde au service du récit et des âmes qui l’habitent.

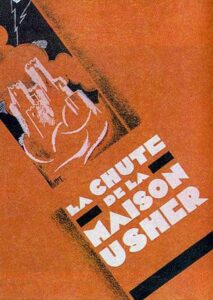




J’ai adoré ce film… Envoûtant…