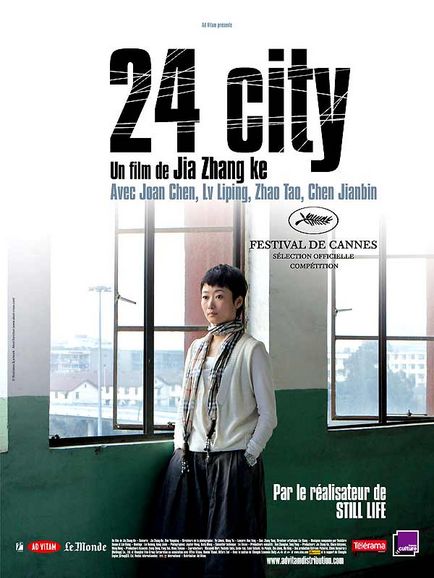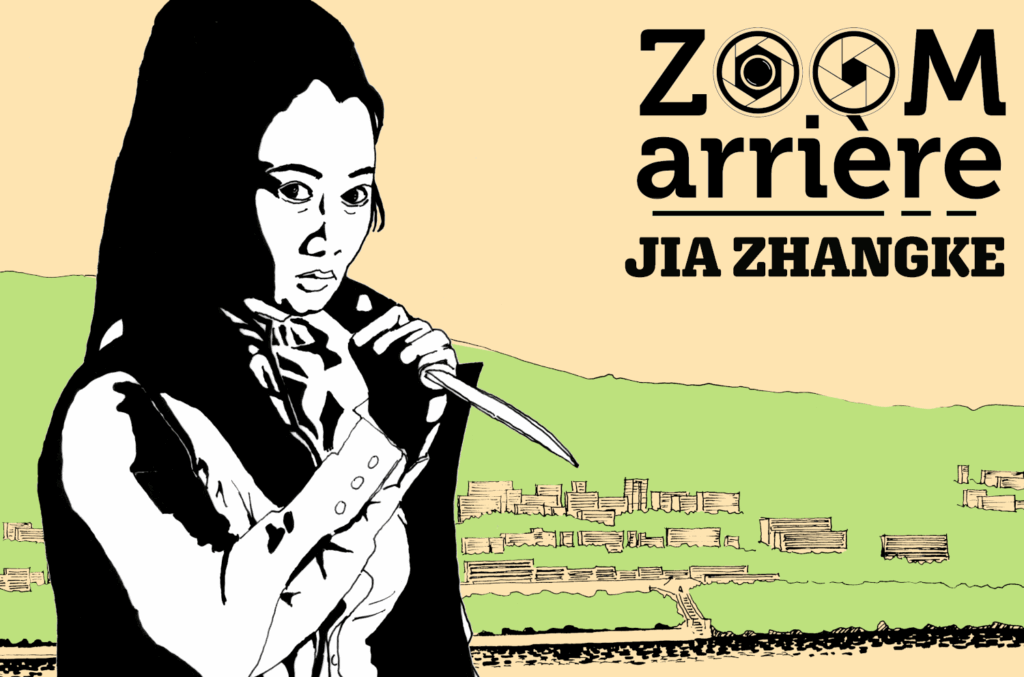Jia Zhang-Ke, 2009 (Chine)
« Dans la cité 24, les hibiscus fleurissaient, Chengdu resplendissait »
Deux ans après la cité engloutie de Fengjet (dans le beau Still life), Jia Zhang-Ke pose sa caméra à Chengdu dans la province du Sichouan. Dans cette ville, l’usine 420, classée jadis secret défense, a durant des décennies été une ville dans la ville. Ses ouvriers et leurs familles (100 000 personnes au total) étaient hébergés sur le site qui mettait aussi à disposition un centre culturel (lieu d’art et de jeux : chants, danse et mahjong) ; on pense bien sûr au paternalisme industriel du XIXe siècle européen (un semblant de bien-être matériel offert aux travailleurs en échange de leur docile soumission). Les conditions de travail dans cette usine métallurgique (spécialisée dans la fabrication de pièces pour avions de l’armée des années 1950 jusqu’aux années 1970, puis reconvertie dans celle de réfrigérateurs et d’autres biens de consommation courante dans les décennies suivantes) paraissent comparables à celles des premiers temps de l’âge industriel occidental (organisation scientifique du travail et sécurité non garantie).
Le cinéaste chinois, à travers huit témoignages et des images d’une cité ouvrière en pleine reconversion, évoque des vies intimement liées à celle de ce monstre industriel. L’usine 420 de Chengdu est démolie et délocalisée. Le site n’aura pas le temps de devenir friche car la modernité exige sans délais l’érection d’un nouveau complexe immobilier : un quartier de gratte-ciel baptisé « 24 City » élevé sur les ruines de cette usine d’Etat restructurée. Jia Zhang-Ke ne filme que les maquettes de plastique de cette modernité…
La suite de cet article est à lire avec d’autres dans les pages du n° 9 de la revue Zoom Arrière, consacré à Jia Zhangke. Commande possible depuis le site Hello Asso.