Brian De Palma, 1976 (États-Unis)
Sa femme et sa fille enlevées meurent dans un accident de voiture. Déjà un véhicule abîmé dans l’eau, accident plus tard coupé au ciseau et collé dans la nuit noire d’un preneur de son (Blow out, 1981). Accident enregistré où jamais sa femme et sa fille ne parviennent à traverser le pont et tombent. Aussi longtemps que l’image repassera, sans fin. Michael Courtland demeure lui-même dans un entre-deux, au milieu de ce pont que jamais il ne franchit. Il continue de vivre mais avec le regard vide, l’image d’Elizabeth et d’Amy incoercible et répétée dans son esprit, bientôt toutes deux confondues jusqu’au trouble. L’obsession de Michael Courtland possède en outre une force déviante capable de ployer l’amour originel pour sa femme jusqu’à l’inceste.
Comme dans plusieurs autres de ses films (Carrie, 1976, Scarface, 1983, Body double, 1984…), Brian De Palma use du cercle comme forme narrative, figure de mise en scène et aspiration cinéphile. Pour ne s’en tenir qu’au cercle, ne prêtons attention qu’à trois importants mouvements circulaires dessinés par la caméra dans le film. Le premier concerne Courtland (Cliff Robertson, vieux beau, qui ne nous plaît guère dans ce rôle) et, de la perte de ses proches, les 360 degrés opérés par l’objectif le conduisent en une ellipse de quinze ans dans le cimetière qu’il leur a réservé et face au monumental tombeau qui, placé sur la ligne du temps comme une montagne tombée sur la route, le bloque et le laisse figé, impuissant au milieu de ses fantômes…
Le second cercle est un panoramique fait, contrairement au précédent, en intérieur, dans la chambre de la mère (à deux ans de la Chambre verte et du sanctuaire aux morts de Truffaut), femme qui est à la fois, pour Courtland aveuglé et sa fille vengeresse, la première aimée et le modèle (Geneviève Bujold à la beauté diaphane, l’actrice incarnant la mère, la fille adulte et l’amante). Ce cercle, plutôt qu’un flash-forward, favorise cette fois un retour du passé. Sandra, l’amour ressuscité de Courtland, trouve le journal d’Elizabeth et le lit. Le passage qu’une voix off nous fait entendre revient sur un paradis perdu, l’épisode florentin en 1959, à savoir sur le bonheur du jeune couple trop tôt brisé (traçons un lien licencieux vers les paradis perdus hitchcockiens, par exemple dans The pleasure garden, 1925, ou Soupçons, 1941).
Le troisième cercle décrit est celui du plan final qui marque les retrouvailles entre le père et la fille bien que les premiers pas de Courtland se fassent un pistolet au poing (son intention première est-elle de se débarrasser de l’imposture ?). Ce cercle embrasse à présent en un travelling les deux personnages après les avoir chacun isolé. Il débute après une course qui, dans son inquiétude (l’arme à feu dissimulée, l’agent de police renversé), par son ralenti et le voile blanc qui recouvre la scène (comme si, dans ce hall d’aéroport, les personnages rêvaient leurs retrouvailles), entre en résonance avec d’autres traces persistantes secrètement conservées dans un creux de la mémoire. Nous voilà ainsi de retour sur La jetée d’Orly (1962) et, car Gilliam réadapte Marker avec L’armée des douze singes (1995), les images qui hantaient Cole resurgissent à leur tour (un aéroport, une course ralentie et une arme) : de l’entrelacement d’ondes voisines. Si l’on sait en outre que ce souvenir chez Marker et Gilliam n’est autre que le souvenir éminemment romantique de la propre mort du personnage, on n’est plus si sûr de voir dans la dernière scène d’Obsession une résolution heureuse. Michael Courtland en acceptant sa fille doit faire le deuil de sa femme et définitivement s’en libérer. Y renoncer c’est d’une certaine manière la faire mourir une seconde fois et se retrouver à nouveau face à un tombeau, celui d’Elizabeth, celui de son amour ou le sien propre….
La figure du cercle répétée n’assure malheureusement pas la perfection du film. Obsession souffre d’un scénario compliqué, pour ne pas dire par moments alourdi. Les emprunts à Hitchcock en témoignent puisque De Palma ne se contente pas d’une réécriture de Vertigo (1958), il ajoute un enlèvement (L’homme qui en savait trop, 1956) qui tel qu’il est annoncé est assez désappointant et, ce qui brouille davantage les pistes, des ciseaux en motif (Le crime était presque parfait, 1954). De plus, le personnage de John Lithgow (le tueur de Blow out qu’un costume blanc ne suffit pas à dégager de tout soupçon) et tout le complot imaginé encombrent quelque peu le récit. La figure du cercle est une figure de perfection mais pour s’en assurer chez De Palma il faudra attendre qu’il creuse davantage son sillon et désespérer ensuite avec un ingénieur devant des bandes son qui tournent toujours dans le vide.

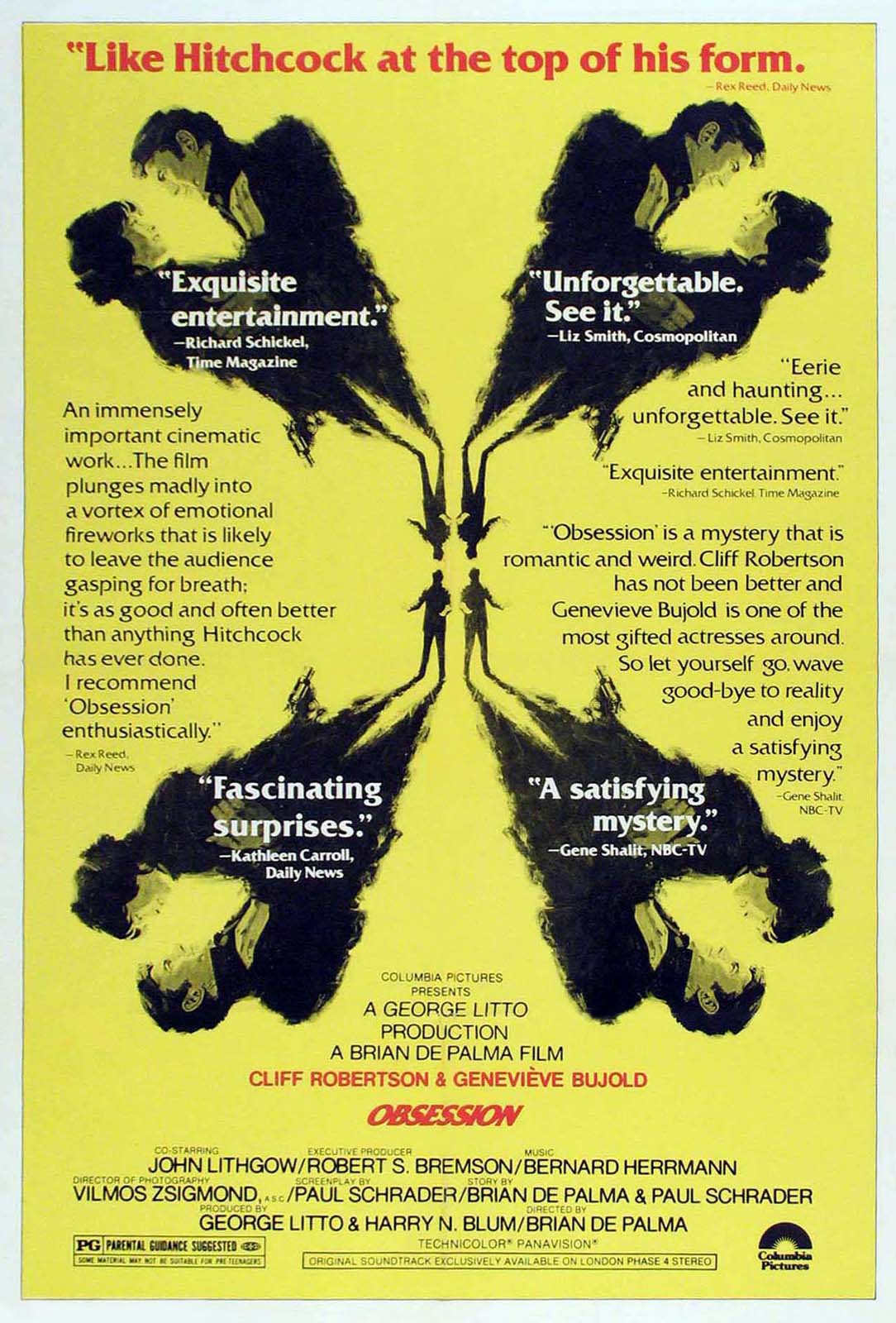
Le courtois Courtland, troubadour égaré en territoire capitaliste ou en pèlerinage italien – naissance des banques là-bas, sans Montana, à la Renaissance -, obsédé par sa trépassée, tourne autour de la gracile restauratrice (de toiles picturales/cinématographiques), représentante d’une espèce dont les jambes en compas cartographient la planète (interdite) du désir, source truffaldienne d’équilibre et d’harmonie, de vide et d’outrages, et Brian tourne autour des deux tourtereaux gentiment incestueux (sacré Schrader, fort marri de l’ablation de son troisième acte avec double ou triple, on ne compte plus, enlèvement, et pas au sérail), aussi inséparables que Les oiseaux transportés à Bodega Bay, aussi damnés que Carrie et sa mère, que le « vieux beau » Jon Voight, papa d’Angelina, avec la fifille de feu Béart, les deux (dés)astres entraînés dans une révolution de travelling circulaire, prisonniers volontaires du cercle vicieux/vertueux de la géométrie du temps perdu et proustien (un paradis déchu ? Celui de Kane, who else ?), et au rythme épique et mélancolique d’une valse soyeuse du génial Herrmann, entiché de l’actrice, si jeune et si vieille Geneviève Bujold, toutes les femmes en une seule, corps sacré puis profané, en rêve, seulement (au spectateur de se faire son blue movie), car baiser une morte, cela ne se peut, sinon sous la lumière nocturne d’une lune refroidie par Bouchitey ou dans les turpitudes teutonnes de Nekromantik – Body double reformulera le fantasme avec son cercueil agoraphobe et sa hardeuse/punkette aryenne-, mais ceci ne suffit pas à l’architecte politique et scopique, qui nous montre par deux fois un panoramique vertical sur un haut immeuble immaculé, siège du félon faussement virginal à son image, monument-pénis en réponse à la courbe matricielle et aux roues du bateau à aubes cherchant vainement à remonter le fleuve temporel, à l’instar de la roue de l’infortune sise au-dessous du volcan par Lowry puis Huston ; oui, tout tourne (mal), dans ce film et dans le monde, dans ce Deep South sans Deep Throat (quoique, embarquement immédiat et avec arrêt sur image pour le septième ciel, Emmanuelle Kristel taillant un pompier au pilote), où plane l’ombre perverse de Faulkner, avec ses amours consanguines, sa langueur déliquescente, les folles répétitions de la langue dans des monologues pleins de bruit et de fureur, de fièvre dans le sang (kolossal Kazan) et le cœur, et la « montagne » sépulcrale plantée sur l’autoroute perdue rime avec le calme bloc mallarméen chu ici-bas d’un désastre obscur, pont vers les fantômes de Murnau munis d’un visage d’ange (Jean Simmons ?) pour mieux faire chuter les mâles à châtier, dont la tête tourne autant que celle du spectateur emporté comme jamais ailleurs (ou alors dans la fumerie d’opium de Leone, dans les étoffes de Wong Kar-Wai, dans la danse sableuse de Visconti épris du bel éphèbe muet), et si Kim Novak vomit à raison l’usage des notes de Vertigo en accompagnement du piètre artiste, que dire de la paresse démontrée par l’auteur surfait de Brazil dans sa ménagerie simiesque, tandis que Marker partait à la recherche de sa Madeleine à lui sur le tarmac d’Orly, puisque les films s’enlacent pour une dernière étreinte (je vous conseille ce Demme mal connu et hitchockien en diable, lui) – mais le bonheur ineffable de retrouver, quitte à la perdre encore, celle que l’on aime, la première et la dernière femme, la gamine et la putain, surpasse tous tes détours, allers-retours, et notre réalisateur, romantique jusqu’au bout du rail (de caméra puis de coke à Cuba) nous abandonne à l’acmé des retrouvailles, ce moment suprême de reconnaissance, de pardon, de fusion filiale : voici Elizabeth/Sandra et Michael enfin délivrés (d’eux-mêmes) et sur le point de vivre leur vie (Godard, admiration de jeunesse de BDP), loin des caméras de surveillance pas encore (?) installées dans l’aéroport, couple improbable réuni sur le ring (Hitch, always) de leur roman familial, sans œil cyclopéen pour les espionner (Snake Eyes) : le lyrisme, au cinéma, possède un nom, et il s’appelle Obsession.
Cette « Obsession » vire donc au cercle vicieux si je suis bien le flot de ton analyse, voir au cercle fermé et restreint de la pure cinéphilie. Sous la lentille de l’analyse, le film devient prismatique, renvoyant à ses multiples reflets passés (de Marker à Hitchcock), présents (Carrie), futurs (12 monkeys). Il faudrait que je me le mire à nouveau, un objectif à la perspective savoureuse.